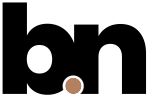#BlackNewsLive. #StanleyClarke, le maître de la basse
|
Ecouter
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Captation images : Vincent Shango / Interview réalisée par Léonard Silva
Stanley Clarke était à Paris dans le cadre du 10e anniversaire du Barrière Enghein Jazz Festival. C’est ce live que nous vous proposons. Nous avions également réalisé une interview il y a quelques années, qui retrace vraiment la carrière et la vision de ce grand maître de la basse. Flashback.
Cinq ans apres If This Bass Could talk, East River Drive marque le retour de Stanley Clarke qui, fidèle à ce qu’il a toujours été, poursuit sa quête de nouvelles sonorités. Avant de s’envoler vers des sommets, convoité par une brochette d’homologues prétendant à la gloire et au respect, ce géant de la basse a fait ses preuves, dans la dure école du « straight ahead jazz » (jazz classique), sous la houlette des maîtres Horace Silver, Dexter Gordon, Gil Evans et Stan Getz.
Cependant, ce sera la rencontre avec un autre jeune loup de la scène jazz, un certain Chick Corea, en 1972, qui va le lancer sur les sentiers d’une grande créativité. Le cadre de ce débordement s’intitule Return To Forever, groupe de jazz-rock avec lequel Stanley va explorer les discours inconnus de la basse électrique auquel il donne un « voicing » nouveau et qu’il propulse au-devant de la scène. Apres s’être forgé un style à la contrebasse, Clarke devient à la basse ce que Jimi Hendrix était à la guitare. A l’instar de son aîné, ce natif de Philadelphie va se muer en véritable « showman » de la basse électrique, maîtrisant quasiment tous les idiomes de la musique populaire, et fait jeu égal avec ses contemporains : Al Di Meola (ex-Return To Forever), Jeff Beck, etc.
De son association avec le sorcier des claviers et producteur George Duke, dans les années 80, naitront quelques bijoux soul-funk-jazz (cf. le hit « Sweet Baby », 1981, Epic). A l’inverse, son passage-éclair avec le batteur Stewart Coppeland (ex-Police) et la chanteuse Deborah (1989), au sein d’un trio avant-gardiste, Animal Logic, n’a pas retenu l’attention du public. If This Bass Could Talk (1988, Epic), n’a pas non plus rencontré les faveurs de la critique spécialisée, coincée dans un intégrisme jazz, comme l’a démontré School Days (Nemperor/Epic 1976), l’album jazz-rock historique de Stanley.
Black News : East Rive Driver concrétise votre recherche panoramique visuelle. Sommes-nous devant une sorte de jazz visuel ?
Stanley Clarke : C’est bien possible, si on se rapporte à mon écriture musicale des cinq dernières années, marquée par une série de bandes sonores de films. Il y a là, une forte influence du visuel dans les textures. Lorsque je pense écriture musicale, des images me viennent automatiquement à l’esprit. C’est ce qui traduit la diversité de cet album dont je suis satisfait.
BN : Outre la facette jazz-funk, l’album explore également la soul avec « Fantasy Love », interprétée par Howard Hewett (ex-Shalamar). Etes-vous en quête de nouveaux espaces?
S.C. : Tout à fait ! Howard Hewett est un ami, et un de mes chanteurs de rhythm ‘n blues favori. J’ai par ailleurs, déjà travaille avec lui à l’époque de Shalamar et au début de sa carrière solo : je lui avais écrit deux morceaux que j’ai produits. C’est pour toutes ces raisons que j’ai fait appel à lui pour cette chanson.
—————————————————————————————————————–
Lire aussi : Carmen Souza rend hommage à Horace Silver
BN : ll y a également cette rencontre avec l ‘Afrique, par la collaboration d’Armand Sabal-Lecco qui nous renvoie un dialogue de basses…
S.C. : J’ai rencontré Armand la première fois à 14 ans, ici, à Paris. Je l’ai revu aux côtés de Paul Simon, mais je me souviens surtout des nombreuses lettres qu’il m’écrivait, dans lesquels il disait vouloir venir me voir, chez moi. Bien que ne l’ayant pas pris au sérieux, je lui ai quand même répondu. Mais (avec un sourire), les lettres sont devenues dures, du genre « Espèce de con, salaud, bout de m… », le tout avec une très belle calligraphie que j’ai trouvée géniale ; je me suis donc intéressé à ce fou. Pendant sa tournée avec Paul Simon, i1 m’a appelé – j’ai eu du mal à croire que c’était lui -, nous nous sommes ensuite rencontrés, chez moi, et nous sommes devenus de très bons amis. Je l’ai invité à participer à mon album car il a cette fraîcheur de jeu de basse marquée par l’influence américaine et par ses racines camerounaises. Il est, à ce niveau, vraiment étonnant, et je pense que ce dont il a besoin aujourd’hui, c’est d’enregistrer un album en étant un peu plus guide, pour devenir une grande figure de la basse…
« Tous les nouveaux bassistes se bornent à copier ce que Jaco Pastorius, Larry Graham, Marcus Miller… et moi avons fait. En ce qui me concerne, j’ai eu de la chance avec mes premiers albums, d’apparaître avec un concept inhabituel, à l’époque jugé bizarre. »
BN : Est-ce une façon de raviver le lien entre l’Afrique et le jazz ?
S.C. : C’est en tout cas une façon de rendre hommage à la musique africaine. Lorsque l’on est Africain-Américain, ce que je suis, vous ne pouvez pas l’éviter. II s’agit d’une réaction viscérale. Dès que j’entends maintenant de la musique africaine – que je connaissais très peu, je réagis naturellement ; elle est dans mes gênes. D’autre part, avant de jouer avec quelqu’un, j’ai besoin de le sentir, d’établir une certaine complicité au niveau des rapports, c’est une question de « feeling ». Il faut que je me sente proche de la personne dans les choses de la vie. Et avec Armand, nous avons eu un long échange, sur son pays, l’Amérique, la vie à Los Angeles, sur des questions de culture. En fait, quand il a débarqué à Los Angeles, c’était bizarre pour lui, puisqu’il ne connaissait pas grand-chose sur les Etats-Unis. Les gens qui l’ont vu croyaient qu’il était un Noir comme n’importe quel autre Africain-Américain. Mais non ! Ils avaient oublié qu’il est Africain et qu’il venait de Paris.
BN : Vous faites partie de ceux qui ont transformé le discours et le statut de la basse. Est-ce que pour vous toutes les possibilités ont été explorées au niveau de l’instrument ?
S.C. : La basse a parfait son évolution la plus importante au cours des quinze dernières années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Peut-être jouer de la basse avec une bouteille ! Je ne sais pas. Mais c’est vrai qu’a part John Patitucci, qui a certaines choses intéressantes, ou peut-être deux bassistes européens dont les noms ne me viennent pas à l’esprit, il n’y a eu pas chose de novateur dans la basse électrique. Tous les nouveaux bassistes se bornent à copier ce que Jaco Pastorius, Larry Graham, Marcus Miller… et moi avons fait. En ce qui me concerne, j’ai eu de la chance avec mes premiers albums, d’apparaître avec un concept inhabituel, à l’époque jugé bizarre. Mais quoiqu’il en soit, j’espère qu’une nouvelle figure va proposer un nouveau langage pour la basse. Peut-être une femme, qui sait ? J’aimerais bien que ce soit une femme.
BN : Parlons un peu de cette résurgence du jazz. Est-ce que selon vous les jeunes rappeurs en échantillonnant la musique des grands noms du jazz, ont contribué à ce que le genre éveille l’intérêt du grand public ?
S.C. : Il s’agit, à la base, d’un phénomène éminemment social. Lorsque l’on est jeune, on a tendance à adopter un certain nombre d’éléments culturels en vogue et ensuite les développer. C’est ce qui s’est passé avec le rap, comme le rock’n roll et d’autres genres populaires. Toutefois, le rap, malgré son côté expérimental, est devenu une affaire de marketing, perdant en quelque sorte de sa superbe musicale. Mais tout ce rapport rap-jazz a un rapport avec une certaine évolution naturelle. D’après ce que m’a dit Dizzy Gillespie, une démarche pareille a eu lieu par rapport au jazz il y a une vingtaine d’années. Je le constate à travers mon fils qui a quinze ans et dont le musicien favori est Wayne Shorter (avec le morceau « Footprints ») ou alors Miles Davis, avec « Kind Of Blue ». Je répète, on est face à un phénomène social.
« On attribue à Wynton Marsalis le titre de porte-drapeau du jazz. Cette exploitation commerciale du jazz est dangereuse et je suis convaincu que les jeunes rappeurs sont venus au jazz, plus par « feeling » que par connaissance de l’existence de Kenny Garret ou Wynton Marsalis. »
BN : Et le jazz, n’a-t-il pas perdu son côté rebelle ?
S.C. : D’une certaine façon ! Prenez le cas de Kenny Garret. Aujourd’hui, quand on parle de jazz, on le cite, parce qu’il vend des millions de disques. D’un autre côté, vous avez Wynton Marsalis qui personnifie le jazz dans toute sa splendeur, et qui, à l’heure actuelle, fait Ia couverture de tous les magazines. On lui a attribue le titre de porte-drapeau du jazz. Cette exploitation commerciale du jazz est dangereuse et je suis convaincu que les jeunes rappeurs sont venus au jazz, plus par « feeling » que par connaissance de l’existence de Kenny Garret, le saxophoniste de jazz (il devient ironique) ou Wynton Marsalis. C’est pour ça qu’ils cherchent ce côté agressif du jazz qui, aujourd’hui, s’exprime de moins en moins. Et tout cela est dû à ce qui passe aux Etats-Unis. Si vous faites une musique qui ne passe pas à la radio, vous cessez d’exister en tant que musicien.
BN : Après tout votre parcours, est-ce qu’il y a encore du terrain pour une certaine expansion musicale ?
S.C. : D’une certaine façon, oui. Je viens de créer mon propre label, qui doit publier prochainement un album live, avec Billy Cobham, Larry Carlton et d’autres musiciens connus, mais mon but, c’est de promouvoir, à l’avenir, des jeunes musiciens. Je viens d’ailleurs d’enregistrer un disque avec de jeunes loups. J’ai également l’intention d’intégrer dans ma musique la dynamique de groupe en matière de création. A ce niveau, j’espère bientôt enregistrer un album-concept, avec une participation diversifiée.
Article d’origine sur Black News magazine (les archives de Black News) : Stanley Clarke : Le « Showman » De La Basse